L’Achewiq est un style ancestral de musique kabyle essentiellement pratiqué par les femmes. Ce genre empreint de poésie est un symbole de cette région montagneuse historiquement éprise de liberté. Reposant principalement sur l’interprétation vocale, il interpelle la sensibilité des auditeurs et suscite une profonde émotion. Dans un court-métrage touchant et pittoresque, Elina Kastler rend hommage aux détentrices de cette tradition.
L’Achewiq : un matrimoine villageois
“Proche de l’istikhbar ou prélude classique, du ay ay saharien, du flamenco espagnol, l’Achewiq kabyle se présente, lui aussi, comme l’émouvante expression tout haut chantée, d’un rêve. C’est une sorte de méditation modulée avec art, sans rythme, mais non sans foi, à laquelle semble se livrer un chanteur inspiré auquel vient répondre comme murmure gonflé, d’une source solitaire, une simple petite flûte, taillée dans le roseau. Et c’est presque toujours un cri de joie ou de souffrance, une confession, une prière, un appel aux besognes que commandent, dans les campagnes, les travaux des saisons et des jours.” C’est ainsi qu’El Boudali Safir, grande figure de l’action culturelle en Algérie dans les années 1940, décrit l’Achewiq à la Radio et Télévision Algérienne (RTA) en 1968.
L’Achewiq désigne un chant poétique kabyle traditionnellement interprété par les femmes. Dans un article de la revue algérienne Insaniyat parue en 2009, Fatiha Tabti Kouidri, maîtresse de conférences à Alger, précise qu’il est “exprimé par des inflexions de la voix qui change d’intensité, de hauteur et parfois même de timbre passant du grave à l’aigu ou inversement.” Achewiq signifie “phrase” en kabyle mais pourrait aussi provenir de l’arabe “ccûq” qui veut dire désir, nostalgie, ou passion. Selon un article de la Tribune paru en 2013, cette appellation regroupe « un vaste répertoire musical et poétique, encore mal défini. Cela va des chants accompagnant le travail domestique jusqu’à une forme de poésie amoureuse exclusivement féminine, en passant par des pièces d’inspiration religieuse exécutées par les mystiques des confréries soufies.«
Dans son étude universitaire “Chants de femmes en Kabylie, fêtes et rites au village”, réalisée à la fin des années 1980 sur la base du répertoire musical de son village d’Aït Issaad, le chercheur et ethnomusicologue Mehenna Mahfoufi y distingue quatre genres musicaux : “les chants exclusivement villageois, définis comme étant constitutifs du répertoire de non professionnels” ; “le répertoire des musiciens itinérants et celui des professionnels tambourinaires (idebbalen)” ; “ le répertoire des artistes chanteurs, ighennayen ou ifennanen, qui sont les auteurs, compositeurs et interprètes de chansons” ; et “les chants que pratiquent les musiciens amateurs du village en reprenant, pour l’animation des fêtes, la musique issue du répertoire des professionnels.”
Transmis de manière orale, les chants villageois auraient résisté à l’épreuve du temps et aux influences étrangères. Ils demeurent néanmoins difficiles à dater et à attribuer. Mehenna Mahfoufi les qualifie aussi de “suites de paroles strophiques chantées sur un air d’origine anonyme”. Au sein même de ce répertoire, l’auteur identifie des catégories distinctes : “Chants patriotiques, chants d’endormissement, sauteuses (déclamation de poèmes faite par une femme à un enfant qu’elle fait sauter sur ses genoux), chants portant sur la guerre de libération nationale, chants liés aux cérémonies de fêtes de mariage, et chants religieux ou adekker interprétés en majorité par des femmes”. Les chants traditionnels des femmes kabyles relèveraient de ce que Constantin Brăiloiu (ethnomusicologue roumain du XXème siècle qui s’est consacré à la collecte et à l’enregistrement de musique traditionnelle dans les villages de son pays) appelle “chant occasionnel”, c’est-à-dire un chant lié à une occasion donnée, et qui ne peut être déclamé que dans le cadre qui lui est prévu.
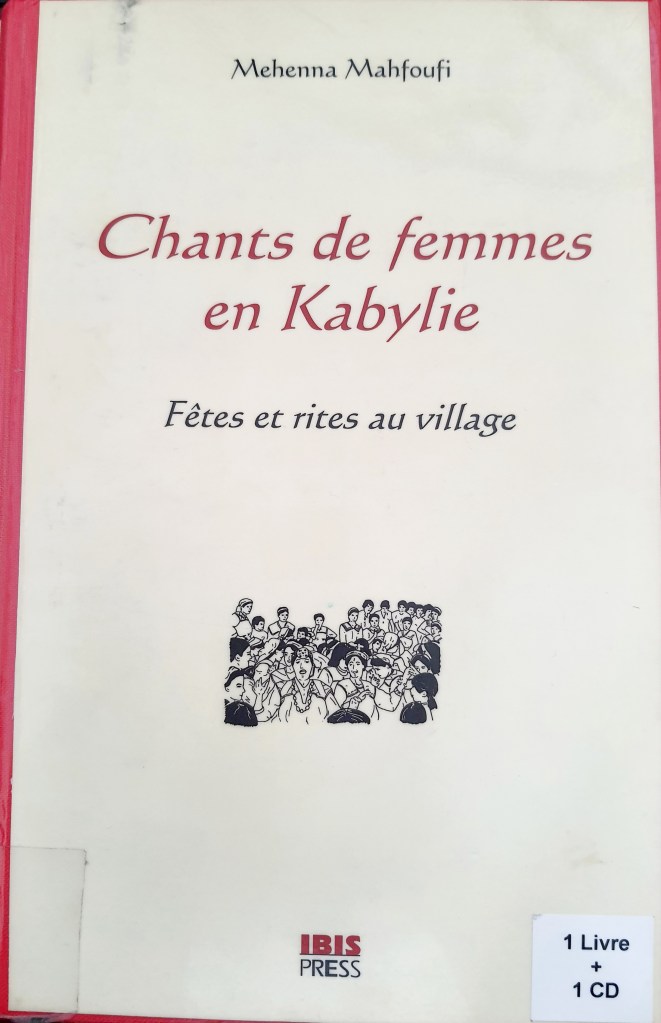
Un hommage aux détentrices de la tradition
Au village de Sahel, dans la commune de Bouzguene en Kabylie, Elina Kastler, réalisatrice au Fresnoy – Studio national des arts contemporains, installe sa caméra. Elle érige les femmes du village en protagonistes de ce court-métrage sur l’Achewiq, dans une région qui se relève au lendemain d’incendies dévastateurs.
Elle capture, pour le plus grand bonheur des yeux et du cœur, des scènes empreintes tantôt de rires, tantôt de larmes, étonnantes de beauté et de sincérité. Les villageoises subliment leur peine par leur Achewiq ancestral : elles confient leurs chants cathartiques au vent, qui, à son tour, les transporte comme un écho d’espoir aux montagnes qui renaissent de leurs cendres. La réalisatrice nous laisse voir les liens forts de sororité et de complicité qui les relient et que reflètent sans surprise l’harmonie et la douceur de leurs chants mélodieux.
Vêtues de leurs robes et foulards colorés, ces paonnes berbères s’abreuvent de leurs méditations chantées et, comme un arc-en-ciel après la tempête, nous laissent deviner des lendemains plus cléments.
Entretien avec Elina Kastler, réalisatrice du court-métrage
- Peux-tu nous dire quelques mots sur toi ?
Je m’appelle Elina Kastler, j’ai 26 ans, je suis une réalisatrice fraichement diplômée du Fresnoy – Studio national des arts contemporains. Je suis aussi comédienne, et c’est pourquoi je porte une grande attention aux personnages dans mes films. Mon expérience en école d’art m’a ouverte sur des formes cinématographiques où fiction et documentaire s’entremêlent. Aujourd’hui, je prépare mon premier long-métrage.

- Ta découverte du chant traditionnel Achewiq est relativement récente. Comment ce nouvel intérêt s’est-il transformé en projet de court-métrage ?
J’ai découvert ce chant il y a plus de trois ans sur internet. Cependant, ma grand-mère le chantait, sans que ma mère sache qu’il s’agissait de l’Achewiq. Ce sont mes recherches autour du chant qui lui ont fait réaliser qu’elle entendait ce chant constamment dans les murs de la maison. Pour être plus correcte, il est judicieux de dire que j’ai découvert le terme et la définition de ce chant il y a trois ans, mais je devais le porter en moi depuis toujours. L’idée d’en faire un film est venue du peu d’informations visuelles et sonores que j’ai trouvées dessus : la culture kabyle étant orale, elle se transmet par la parole. Dans notre société où les cultures s’entremêlent, circulent et se diversifient, j’ai eu le désir de faire un projet où l’image et le son rendaient hommage aux femmes qui préservaient le chant. L’Achewiq est un chant avec une force émotionnelle sans pareil ; en tant que réalisatrice, j’ai tout de suite souhaité m’embarquer dans une aventure filmique pour déployer ces émotions. - Tu t’es attelée à un projet de tournage en Algérie, de surcroît au plus près d’une communauté de femmes dans un village traditionnel, avec les difficultés que cela peut supposer. Comment s’est déroulé le tournage ?
C’était la première fois que je me rendais en Algérie. Loin d’être difficile, ce projet était empreint d’un désir initiatique de retrouver la terre de mes ancêtres. J’avais, en amont de mon arrivée, rencontré la communauté berbère de France. Je filmais déjà en France, je connaissais des chanteuses incroyables, j’ai participé à de nombreux évènements. Tout ce travail en France m’a permis de construire un réseau culturel en Algérie. Ce sont mes amitiés en France qui ont établi un lien avec les artistes et les défenseurs de l’art en Kabylie. Arrivée sur place, j’ai donc retrouvé des personnes que j’avais rencontrées à distance. Mon désir de faire un film sur l’Achewiq a très vite plu, j’ai rencontré de nombreuses femmes, dans des villages comme en ville, qui souhaitaient partager avec moi leur chant et leurs expériences. Toutes ces rencontres étaient merveilleuses. J’ai cependant dû faire un choix. Quand je suis arrivée à Sahel, pour rencontrer cette association de femmes très connue, il s’est passé quelque chose de très fort entre nous. Elles m’ont accueillie comme si j’étais des leurs. J’ai vécu avec elles pendant un mois. Ce lien que j’ai ressenti, j’ai décidé de le montrer dans le film. J’espère que les autres merveilleuses rencontres que j’ai faites vont pouvoir être visibilisées dans le long-métrage, un format qui me permettra d’élargir mes propos. - Que représente aujourd’hui l’Achewiq pour les femmes que tu as rencontrées ? Quand et comment le pratiquent-elles ? As-tu constaté une transmission de cette tradition aux plus jeunes générations ?
Le duo Taos et Mansissa fait partie de mes plus belles rencontres. Manissa est une jeune femme de mon âge avec une voix en or. Elle apprend des chants traditionnels de sa grand-mère, Taos. Quand elles chantent ensemble, leurs voix s’harmonisent et créent une atmosphère où l’expérience de la vie et l’émerveillement du monde s’accompagnent. C’est magnifique. Manissa poursuit son rêve de musique, et je pense que cela vient en partie de la transmission de Taos. J’ai aussi rencontré des femmes merveilleuses qui proposaient des cours de chant pour les jeunes, afin de les ouvrir sur la puissance des poésies. Je n’en dis pas plus, mais il y a quelques rencontres qui me prouvent que l’Achewiq se transmet encore, que son pouvoir reste toujours ancré en nous. Je souhaite justement porter ce sujet en avant dans mon long-métrage. Sans exception, toutes les femmes que j’ai rencontrées et qui me parlent de l’Achewiq le définissent comme un chant catharsis, un chant réparateur. Elles me disent toutes : “les souffrances sont telles qu’elles ne peuvent être que chantées”. L’Achewiq est un exutoire. Il est porteur de l’émotion et du vécu de celle qui le chante. C’est aussi pour cela que la voix seule suffit. - Les images que tu as capturées témoignent d’une profonde immersion dans le quotidien de ces femmes. Comment as-tu vécu cette expérience ? Quels moments t’ont particulièrement marquée ?
Sans trop me poser de questions, je suis allée à Sahel et j’ai passé mon quotidien avec les femmes, en particulier Ouiza et sa maman Taos. Je dormais avec elles, j’allais au jardin avec elles, nous mangions ensemble… Ce n’est que lorsque ma cheffe opératrice, Juliette Barrat, est venue de France qu’elle m’a éclairée sur la situation : “Elina, ton lien avec ces femmes est familial. Elles t’appellent ‘ma fille’, tu chantes avec elle, il y a tant de tendresse entre vous”. Bien que peu d’images de Juliette soient présentes dans le film (les images merveilleuses de la fin et les paysages du film sont d’elles), elle a changé ma manière de penser le film. C’est grâce à son analyse et à son regard que j’ai commencé à filmer à mon tour de manière plus directe, plus familiale. J’ai commencé, à partir de ce moment-là, à utiliser la caméra comme mon regard. C’était une expérience merveilleuse. Je garde en particulier les moments de sketchs que Ouiza nous a offerts, presque tous les soirs, à la fin de mon séjour. Nous nous réunissions avec les femmes du quartier et Ouiza se déguisait, en imitant des hommes ou des femmes. Ce sont les moments les plus drôles de mon séjour. Je retiens aussi avec grande tendresse ces temps de chants et de danse, où nous étions toutes réunies chez Ouiza. C’était la fête, qu’est ce que nous riions ! Un autre temps, moins collectif, mais tout aussi marquant, reste ma relation avec Taos, la maman de Ouiza. Il m’arrivait d’être seule dans la pièce avec elle. Je ne parle pas kabyle et elle ne parle pas français. Pourtant, elle ne cessait de me raconter des histoires de sa vie. Je l’écoutais, sans comprendre. Elle me rappelait ma grand-mère, que je ne comprenais qu’au travers de l’extra-verbal. Nous n’avions pas la même langue, mais nous communiquions tout de même. Cette profonde immersion vient du sentiment sincère d’avoir renoué avec une famille. Je pense que ma grand-mère n’a cessé d’être à mes côtés pendant le projet. - Le film a récemment été présenté aux Rencontres Cinématographiques de Béjaïa, la première projection en Kabylie ! Qu’as-tu ressenti à cette occasion ? Comment a réagi le public ?
Il est vrai que cette projection était pour moi la plus stressante et le plus effrayante ! Montrer le film dans la région où il a été tourné me donnait beaucoup de pression. Il est toujours effrayant de montrer ses films à un public, mais la seule fois où j’ai ressenti un tel stress c’est lorsque les femmes sont allées le voir à Alger ! Comme je n’étais pas présente physiquement cependant, j’arrivais à mieux contrôler mon stress. J’ai eu la chance de présenter le film lors d’une programmation exceptionnelle aux RCB. Les deux autres films qui étaient projetés avec Achewiq étaient merveilleux, sublimes. Les trois films se répondaient, ils étaient liés par les mêmes poésies. Je remercie Nabil Djedouani, le programmateur de cette séance. Celle-ci a suivi un long-métrage incroyable, intitulé “Le marin des montagnes” de Karim Aïnouz, qui revient aussi en Algérie pour retrouver son identité. Ce film a vibré en écho à mon expérience. C’était magique. Bien évidemment, le public était formidable. Pendant la projection, je pouvais les entendre rire à gorge déployée. Ils n’hésitaient même pas à applaudir ! C’était merveilleux, vivant et très émouvant. Je remercie chaque personne d’avoir été présente pendant le film. - Ton documentaire a parcouru de nombreux festivals et a récemment remporté l’Onion Seed Award au festival Makedox en Macédoine, félicitations ! Quels sont tes prochains projets, en lien avec l’Achewiq et en général ?
Un grand merci ! Je suis ravie que le film soit autant représenté à l’international. J’ai contribué, à ma modeste manière, à ce que l’Achewiq soit entendu dans plusieurs pays et continents. J’en suis très heureuse. La plus grande richesse, c’est d’entendre des personnes venant du Portugal, de Macédoine du Nord, d’Inde, d’Indonésie ou du Sénégal me confier qu’ils ont eu le sentiment de revoir leurs grands-mères. Cela montre que ce chant ne concerne pas que les algériens, qu’il trouve un écho dans le cœur de nombreuses cultures. J’en suis profondément marquée.
Le film a été réalisé dans le cadre de mes études au Fresnoy. Il est très difficile pour beaucoup de le croire, mais sa vie en festival et les deux prix qu’il a remportés n’ont pas généré d’argent. C’est très difficile de parvenir à vivre de la réalisation, et les courts-métrages ne sont pas le meilleur modèle économique. C’est l’une des raisons pour lesquelles je me tourne aujourd’hui vers la réalisation de long-métrage. J’ai aussi le sentiment profond que le court-métrage ne m’a pas permis d’explorer l’océan de richesse que représente l’Achewiq. Comme j’en parlais plus tôt, la transmission joue une part essentielle à ce chant. L’Achewiq est un espace mémoriel féminin, et sa puissance vient aussi du fait qu’il soit le témoignage de la vie des femmes tout en retraçant l’histoire de l’Algérie. Il me semble nécessaire de déployer ces thématiques, de les visibiliser. C’est pourquoi, soutenue par la société de production Alpha Tango Studio (en Algérie) et Lady Birds Film (en France), j’entame ce projet de long-métrage sur Achewiq.
Pour finir sur les mots d’Elina Kastler : « Il y a une résonnance universelle quand on parle d’un chant qui permet de se libérer du poids de la vie. L’Achewiq a un pouvoir intime et collectif. Il est un océan qui nous ouvre sur les souffrances des femmes et leurs émotions les plus profondes. Je souhaite qu’il se déploie en un projet cinématographique artistique, démontrant que l’art, de quelque manière qu’il soit, permet de se libérer des maux. »
Pour aller plus loin :
Achewiq, le chant des femmes-courage, Le Fresnoy
Chants de femmes en Kabylie, fêtes et rites au village, Mehenna Mahfoufi, Bibliothèque de l’Institut du Monde Arabe
La culture orale, une tribune pour les groupes dominés : la chanson populaire, un lieu d’émergence du discours féminin, Fatiha Tabti Kouidri, Revue Insaniyat
« Acewwiq » : menaces sur un chant profond de la Kabylie, La Tribune, djazairess.com
Samira Taïbi


Laisser un commentaire